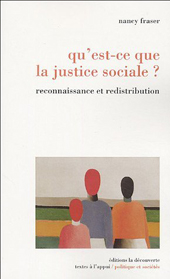Cet article peut particulièrement faire suite au #14 qui traitait de la critique néolibérale et libertarienne de l’Etat-providence et de la justice sociale.
Dans une série de deux articles[1], Ronald Dworkin s’est proposé de replacer les notions de responsabilité individuelle et de mérite dans une théorie de l’égalité. Cette opération consiste à pouvoir justifier contre les critiques de l’idéal redistributif que l’égalitarisme peut être compatible avec des notions utilisées communément par ceux-là mêmes. Dworkin, à cet égard, reconstruit l’égalitarisme à partir d’une critique de l’égalité du bien-être classiquement comprise dans le welfare state pour proposer une égalité des ressources qu’il s’agira de définir.

Cette égalité des ressources se fonde sur l’idée selon laquelle les mécanismes redistributifs doivent prendre en compte le fait que dans le groupe des personnes défavorisées, certains y sont selon des circonstances qu’ils n’ont pas choisies et d’autres le sont d’après leurs propres choix, et qu’ils sont donc responsables de leur situation. Dworkin doit alors reconstruire et justifier un système de redistribution qui intègre pleinement la responsabilité individuelle, cette même responsabilité qui pour les libertariens ne justifiait en rien le recours à une compensation par le biais de la redistribution. A contrario, Dworkin soutient que cette dimension peut la justifier. Nous verrons que cette tentative fera de nombreux émules notamment avec les partisans de ce que l’on appelle en anglais le luck egalitarianism[2].
Une telle reconstruction s’appuie, chez Dworkin, sur la distinction entre ce qui dépend de l’individu et ce qui dépend du contexte. Ce qui dépend de l’individu est l’objet de ses choix, ce qui dépend du contexte ou des circonstances est subi et donc non choisi par l’individu. L’idée est qu’il est juste de compenser les inégalités dues au contexte ou aux circonstances mais que rien ne justifie de redistribuer les ressources quand une situation défavorable découle strictement des choix de la personne. L’enjeu, outre celui de répondre aux critiques néolibérales, est d’envisager la théorie de la justice dans une perspective éthique. En effet, si une théorie de la redistribution occulte les choix opérés par les individus, leur dimension éthique est elle-même aussi mise à l’écart. Contre Rawls, Dworkin prétend fournir une théorie de la justice comme fondement de la vie bonne.
Dans la première partie de « What Is Equality ? »[3], Dworkin s’oppose tout d’abord à ce que l’on appelle l’égalité du bien-être, égalité selon laquelle la société est juste si les individus ont un niveau égal de bien-être. Le problème qui se pose est que tout le monde n’a pas les mêmes préférences. A cet égard, Dworkin oppose à l’égalité du bien-être un argument désormais classique, celui des « goûts dispendieux »[4]. Dans ce cadre, si l’on considère deux personnes A et B, A possède des goûts plutôt modestes et s’accommode très bien d’un mode de vie frugal, à l’inverse B ne peut éprouver de la satisfaction qu’avec des objets luxueux, il faudra accorder plus de ressources à B qu’à A pour pouvoir égaliser leur satisfaction. Cette conséquence est inacceptable puisqu’elle égalise les conséquences de choix des individus tout en octroyant des ressources différentes selon que leurs goûts soient dispendieux ou non.
De plus, selon Dworkin, elle évacue pleinement la responsabilité puisque dans tous les cas de figure, les conséquences des choix des individus seront toujours compensées pour assurer leur niveau de bien-être. Cela entraînerait notamment un gaspillage rapide des ressources si la propension aux goûts dispendieux s’étendait à l’ensemble de la population. L’égalité du bien-être est ainsi contraire à l’efficacité. Mais l’enjeu le plus important est de montrer pourquoi elle est aussi contraire à l’égalité[5]. L’égalité du bien-être dénature paradoxalement le principe d’égalité. Elle suppose une conception unique du bien-être incompatible avec le principe du choix de la vie bonne pour chacun individu.
Une fois écartée l’hypothèse irrecevable de l’égalité du bien-être, Dworkin peut avancer sa propre thèse : celle de l’égalité des ressources[6]. Elle sera justifiée à travers les trois étapes d’une expérience de pensée. Il entend montrer qu’une telle égalité peut être intégrée dans le cadre d’une économie de marché et qu’elle est parfaitement compatible avec les valeurs d’efficacité et de liberté. Pour ce faire, il demande au lecteur d’imaginer la situation suivante[7] : un bateau a échoué sur une île déserte qui présente d’abondantes ressources. Les naufragés acceptent qu’aucun d’entre eux n’ait de droit exclusif sur ces ressources. Il s’ensuit une division de celles-ci selon un système de vente aux enchères dont l’équité est garantie par une égalité de pouvoir d’achat pour chaque individu (admettons que chacun ait à sa disposition cent coquillages). Un naufragé a été élu pour organiser la vente aux enchères et mettre en place des packs de ressources qui se distinguent par leur contenu, une parcelle de terrain cultivable, des outils, etc. Les individus achètent les packs de ressources selon leurs préférences et leurs projets de vie sur l’île.

Cette situation permet de passer le test dit d’envie que Dworkin caractérise de la manière suivante : « Aucune division des ressources n’est égale si, une fois la division effectuée, un naufragé préfère le pack de ressources d’un autre par rapport au sien »[8]. La vente est terminée et légitime au moment où ce test est réussi. Si un individu est insatisfait, il peut toujours enchérir davantage pour obtenir le pack désiré de ressource. Cette expérience de pensée nous permet, selon Dworkin, de dire que les individus ont été traités avec un égal respect à partir d’une égalité de ressources ex ante. Comme l’indique Will Kymlicka[9], le test d’envie permet en outre d’accomplir les trois objectifs de la théorie de la justice de John Rawls : « le respect de l’égalité morale des individus, la compensation des désavantages moralement arbitraires et la responsabilité à l’égard de nos choix. » Il demeure des inégalités de revenu, mais chacun est satisfait de ce qu’il a obtenu aux termes de la vente aux enchères et accomplit son mode de vie comme il l’entend.
Néanmoins, cette situation contrefactuelle suppose que tous les individus soient également capables de bénéficier de leurs ressources. Or, dans le monde réel, certains possèdent des handicaps tels qu’ils ne peuvent à ressources égales avec des personnes dites valides profiter réellement de leurs ressources. Le deuxième temps de l’expérience de pensée de Dworkin intègre la problématique des handicaps. Une fois que l’on a pris en compte la possibilité des handicaps, on remarque que le test d’envie ne peut plus être satisfait. La personne qui possède par malheur un handicap préférerait être à la place d’une autre qui n’en possède aucun et qui peut jouir de ses biens. La théorie de la justice doit prendre en compte le fait que certaines circonstances de la vie échappent au contrôle des individus et les empêchent de se poser en tant qu’égaux avec les autres. Une société juste doit compenser ces circonstances pour corriger les déficits de ressources que subissent les individus souffrant de handicaps.
Inquiétude des naufragés quant au partage des coquillages
L’expérience de pensée se corrige de la manière suivante : le système d’enchère est couplé à un système d’assurance contre les circonstances handicapantes[10]. L’idée est de tenir compte, outre de ces dernières circonstances, des choix des individus et des conséquences chanceuses ou non qui en découlent.
Dworkin distingue ainsi deux types de chances[11] : l’option luck et la brute luck[12]. La première contient l’idée que l’on accepte de prendre des risques car on peut parier que l’on pourra avoir soit des gains soit des pertes. La seconde perd cette faculté d’anticipation. Ainsi, si mes gains s’élèvent après avoir spéculé en bourse, alors mon option luck est bonne. Si une météorite me tombe dessus sans que j’aie pu le prévoir, j’ai une bien mauvaise brute luck. Cette distinction permet de dégager l’idée de responsabilité. En effet, si je ne suis guère responsable de la brute luck (je contracte un cancer sans avoir jamais avoir eu de comportements à risques), les conséquences de ce que j’aurais pu prévoir dans le cadre d’une option luck peuvent le cas échéant m’être imputées (je souffre d’un cancer après avoir pendant longtemps fumé des cigarettes, j’ai fait un mauvais pari). Nous pouvons dégager, dans cette optique, différents types de comportements, ceux qui ont part à une prise de risque assumée, ceux qui témoignent d’une préférence de vie calme sans prise de risque. Le premier type inclut la responsabilité du choix, peu importe que les conséquences soient bonnes ou mauvaises. L’auteur du choix risqué savait qu’il pouvait perdre son pari.
La possibilité de s’assurer contre les coups du sort entre en jeu. L’avantage d’une telle assurance est, comme l’indique Dworkin[13], de lier l’option luck à la brute luck. En effet, souscrire ou non à une assurance revient à une prise de risque calculée.
Dans le système d’enchère, l’inclusion d’un mécanisme hypothétique d’assurance s’opère de la manière suivante : les naufragés disposent à présent d’une prime fixe d’assurance dont le montant correspond à ce qu’un naufragé serait prêt à payer en sachant qu’un handicap pourra arriver à tous de manière égale.
Dworkin distingue dès lors ce qui relève de l’individu et ce qui relève des circonstances ou du contexte[14]. Ce qui relève de l’individu sont les goûts (dispendieux éventuellement) et la propension au risque, les aspirations pour l’avenir. Ce qui relève du contexte sont les handicaps possibles ainsi bien sûr que les capacités mentales ou physiques.
L’égalité des ressources demande que ce qui relève de l’individu soit assumé par lui-même mais que ce qui ne relève en aucune manière d’un choix strict soit compensé par la communauté. Ce qui ne relève pas du choix, c’est-à-dire du contexte ou des circonstances, comprend les handicaps (cécité, paraplégie, etc.) qui ne sont pas causés à la suite d’une action volontaire et risquée de l’individu ainsi, comme le précise Dworkin, que le manque de talents.
Le manque de talent peut être effectivement préjudiciable pour les individus. Les conséquences d’un handicap moteur m’empêcheront de la même manière qu’un manque de talent en la matière de produire certains biens, comme une récolte dans un potager. De plus, le manque de talent rompt également le succès du test d’envie. Si A possède un terrain et qu’il parvient grâce à ses talents de cultivateur à récolter un nombre important de légumes, B ou C avec une terre de même qualité mais sans compétences particulières seront sans doute envieux des compétences de A.
Il faut une nouvelle fois amender l’expérience de pensée pour intégrer les disparités de talents. De la même manière que pour les handicaps, on peut imaginer que les individus s’assurent contre la possibilité de ne pas posséder un certain talent[15]. Le problème est de savoir comment trouver un système qui compense les effets des différences de talents tout en préservant les conséquences des choix dont les individus demeurent foncièrement responsables[16]. Dworkin imagine ainsi que les naufragés puissent souscrire à des assurances qui leur assurent une compensation financière contre un tort qui serait causé par un éventuel manque de talent. Dworkin suppose que les individus sont placés, pour reprendre des termes rawlsiens, sous un voile d’ignorance[17] qui occulte les talents dont ils disposent mais qui laisse transparaître la distribution des talents à travers l’ensemble de ceux-ci. Les personnes peuvent donc estimer quelle sera leur chance de posséder un certain talent.
Contre le risque de ne pas posséder un talent exceptionnel, le prix de la prime d’assurance sera très élevé.
Dès lors, peu d’individus seront prêts à dépenser une telle somme d’argent pour si peu de chance de gain[18]. De plus, celui qui aura souscrit à cette assurance et qui disposera effectivement d’un grand talent sera perdant puisqu’il devra soutenir une activité importante pour pouvoir continuer à payer des primes très coûteuses.[19] En conséquence, les individus seront davantage prêts à payer des primes contre les risques de ne pas avoir de talents moyens et les ressources qui en découlent. On atteint ainsi une certaine optimalité entre le risque de ne pas avoir de talents et un niveau moyen assuré de ressources. Comme l’écrit Jean-Fabien Spitz, Dworkin peut conclure « qu’il existe un niveau moyen de talents et de revenus correspondants que les gens chercheront à se garantir en souscrivant une assurance s’ils sont dans une situation où ils ignorent quels seront leurs talents effectifs ».[20]
Dans le monde réel, le système d’assurance peut être concrétisé à un travers un système d’impôt progressif. Ceux qui se trouvent au-dessus du niveau moyen de talents et de revenus correspondants payent des impôts pour financer une redistribution envers ceux qui sont situés en-deçà. On pourrait objecter à Dworkin que l’implication qu’il semble tenir entre les talents et les revenus est plutôt contingente. En effet, certains individus talentueux n’ont peut-être pas l’ambition de faire fructifier leur savoir-faire pour en dégager un revenu.
Spitz précise et résume : « Dworkin montre ainsi que la notion de l’égalité des ressources nous porte dans deux directions distinctes : la répartition des ressources doit demeurer sensible aux projets, aux ambitions, aux décisions relevant de la personnalité de chacun, mais elle doit être insensible aux différences de dotations, c’est-à-dire qu’elle ne peut être légitimement affectée par une différence des talents du genre de celle qui conduit à des différences de revenu dans une économie de laissez-faire parmi des individus qui ont les mêmes projets et ambitions. Et surtout, il montre qu’il est possible de procéder à cette compensation de talents sans porter atteinte au principe de responsabilité – c’est-à-dire sans rendre les choix des individus moralement indifférents. »[21] C’est pourquoi, par ailleurs, Dworkin déclare que le libéralisme rawlsien ne peut être authentique en écartant la dimension morale du choix individuel.
On voit bien à présent en quoi la proposition de Dworkin est, en ce sens et en même temps, une réponse à la doctrine néolibérale et une proposition d’amendement d’un Etat-providence en déliquescence.
A suivre !
[1] Dworkin (1981a) et (1981b), aujourd’hui regroupés dans Dworkin (2000), c’est à ce dernier ouvrage que nous nous référons.
[2] Il n’est pas d’usage de traduire cette formule et effectivement il serait difficile de trouver une expression en français qui permette de recouvrir l’ensemble du concept. Plutôt que de recourir à une version maladroite, nous nous en tenons à l’expression originale due, par ailleurs, à Elisabeth Anderson (1999) Page 289.
[3] Dworkin (1981a), (2000) page 11.
[4] Dworkin (2000) Page 48.
[5] Spitz (2008) Pages 46-47.
[6] Dworkin (1980b), (2000).
[7] Dworkin (2000) Pages 66.
[8] Ibid. Page 67. Nous traduisons.
[9] Kymlicka (2003) Page 92.
[10] Dworkin (2000) Page 80.
[11] Ibid. Page 73.
[12] Ces termes paraissent difficilement traduisibles en français sans tomber dans l’équivoque.
[13] Dworkin (2000) Page 74.
[14] Ibid. Page 81.
[15] Ibid. Page 93.
[16] Ibid. Page 91.
[17] Un voile moins opaque que celui de Rawls puisque la répartition des talents est connue des personnes.
[18] Dworkin (2000) Page 95.
[19] Spitz (2008) Page 62.
[20] Ibid. Page 63.
[21] Ibid. Page 65
Biblio
Anderson Elisabeth (1999) « What is the point of Equality? », Ethics, 109.
Dworkin Ronald (1981a) – « What is Equality? Part 1: Equality of Welfare », Philosophy and Publics Affairs, 10, pages 185-246.
Dworkin Ronald (1981b) – « What is Eauality? Part2: Equality of resources », Philosophy and Publics Affairs, 10, pages 283-345.
Dworkin Ronald (2000) – Sovereign Virtue, the Theory and the Practice of Equality, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press.
Kymlicka Will (1999) Les théories de la justice, une introduction, trad. Marc Saint-Upery, Paris, La Découverte.
Spitz Jean-Fabien (2008) Abolir le hasard, responsabilité individuelle et justice sociale, Paris, Vrin, Coll. Philosophie concrète.